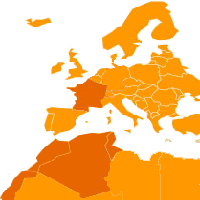DESCRIPTION DU PROGRAMME
|
||||||||||||||||
Ce projet d'appui à la coopération pour la recherche en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France s'articule autour de trois axes :
- Projets de recherches conjointes sur des thématiques
prioritaires et pluridisciplinaires (favoriser la constitution de réseaux) ;
- Échanges, formation et mobilité, formation
de jeunes chercheurs, circulation d'enseignants, co-tutelles, bourses
de stage, recherches de terrain, universités d'été... ;
- Accès à l'information scientifique, traductions et publication des ouvrages fondamentaux en français et en arabe, formations linguistiques des enseignants et chercheurs monolingues, développement de la numérisation de l'information scientifique (revues, ouvrages, rapports de recherche, thèses, dictionnaire des SHS).
La mise en œuvre du projet comprend quatre composantes :
![]() Composante 1 : Développement de projets de recherche conjointe sur des
thématiques prioritaires et pluridisciplinaires
Composante 1 : Développement de projets de recherche conjointe sur des
thématiques prioritaires et pluridisciplinaires
Six thématiques de recherche, toutes pluridisciplinaires, ont été retenues comme prioritaires. Une proposition peut couvrir plusieurs de ces thématiques :
|
Thématiques
|
Entrées disciplinaires
|
|
1) Héritages, Identités méditerranéennes, convergences et divergences, lieux et politiques de la mémoire. |
Histoire, littérature, psychologie sociale, anthropologie, philosophie, éthique et sciences politiques. |
|
2) Ouverture des économies et des sociétés méditerranéennes, dynamiques des institutions, des entreprises et des comportements. |
Économie, droit, sociologie, sciences politiques. |
|
3) Contacts de langues en Méditerranée, migrations et mobilités. |
Linguistique, démographie, sociologie. |
|
4) Les processus sociaux en Méditerranée : acteurs, systèmes, pratiques et stratégies. |
Sociologie, droit et économie. |
|
5) Les processus de territorialisation en Méditerranée : dynamiques rurales et dynamiques urbaines. |
Géographie, sociologie, économie, urbanisme. |
|
6) Activités humaines, ressources et durabilités économiques, socioculturelles et environnementales. |
Sciences de l'environnement, économie, anthropologie sociale. |
Thématique 1 : Héritages, Identités méditerranéennes, convergences et divergences
Les concepts d'héritage et de patrimoine ont pris aujourd'hui une importance fondamentale dans la réflexion et les comportements de toutes les sociétés par rapport à leur passé, sur lequel elles cherchent à fonder leur identité présente et leurs choix pour l'avenir.
Ils constituent à ce titre un axe de recherche fondamental pour les sciences humaines et sociales. L'archéologie et la muséographie visent à récupérer, conserver et faire connaître les passés disparus et souvent oubliés. La linguistique et l'ethnologie, l'anthropologie culturelle et, pour une part, la sociologie étudient en revanche les multiples présences du passé dans le présent. Toutes les disciplines s'interrogent sur la formation et la transmission des différentes formes de mémoires individuelles et collectives, par leurs démarches et leurs actions, à préciser et à redéfinir.
Le bassin méditerranéen dans son ensemble, et le bassin méditerranéen occidental en particulier, constituent de ce point de vue un espace d'études privilégié. Ils combinent en effet des traits communs, ou du moins proches et comparables, liés aussi bien à l'influence du milieu qu'à des moments d'histoire commune et à la continuité des circulations et des échanges, mais aussi de fortes spécificités locales et régionales, qui renvoient au contraire aux périodes où ces histoires se sont séparées, souvent mal comprises et ignorées, et parfois affrontées.
Cette tension entre passé et passés, entre références
communes et affirmation des différences et d'identités particulières
inscrites elles aussi dans l'histoire, fait l'intérêt exceptionnel
de cet axe de recherche aujourd'hui, dans un contexte où des formes
de nouveaux partenariats entre les deux rives de la Méditerranée
sont à l'étude et à l'ordre du jour.
Les pays des deux rives de la Méditerranée ont mis en œuvre, depuis le début des années 1960, des politiques économiques correspondant à des logiques différentes : logique de l'intégration européenne pour la rive nord, logique de la construction d'économies nationales, à la fois autonomes et tournées vers le développement sur la base de la valorisation de leurs ressources propres, pour les pays de la rive sud.
Des accords entre l'Union européenne et les pays de la rive sud ont, au cours de la période récente, visé à surmonter cette opposition, et à ouvrir aux seconds l'accès au grand marché en expansion que constituait la première.
La création de l'espace Schengen est venue de son côté modifier les conditions de circulation des flux migratoires à l'intérieur de l'Union européenne et a conduit celle-ci à redéfinir une politique d'immigration jusqu'ici fixée par les différents États en fonction de leurs besoins et de leurs préoccupations propres.
Le problème est donc d'étudier aujourd'hui de façon comparative l'évolution économique de l'ensemble de la région, et de replacer celle-ci dans le cadre plus général de la libéralisation accrue de la circulation des biens marchands, des capitaux et des informations. Il est aussi de voir si et comment le partenariat euro-méditerranéen peut favoriser non seulement l'ouverture des économies et des sociétés maghrébines, mais aussi leur développement durable et équilibré, dans le respect de leurs spécificités propres.
Une place importante doit être faite à l'étude du
comportement des acteurs, ainsi que des configurations institutionnelles
héritées de l'histoire ou nées au contraire de l'adaptation
aux situations présentes, ou encore des formes et des stratégies
des différents types d'entreprise, dans un contexte marqué
par un double processus de mondialisation et de régionalisation.
Thématique 3 : Contacts de langues en Méditerranée, migrations et mobilités
La multiplicité des langues en Méditerranée pose à la fois la question de l'affirmation des identités qu'elles expriment et celle de la communication nécessitée par les échanges.
L'étude des contacts de langue dans les situations migratoires
et les contextes de mobilités est susceptible d'apporter une contribution
à l'élaboration des politiques sociales, linguistiques et
éducatives dans les pays du pourtour méditerranéen.
C'est ainsi que la connaissance des pratiques langagières de groupes
sociaux, touchés par les déplacements ou les migrations,
est particulièrement utile pour la définition de cadres
d'action visant à l'appropriation et à la maîtrise
des langues par les différentes générations dans
des contextes de multilinguisme.
Il conviendrait donc d'étudier les contacts de langues dans une
perspective comparative et interdisciplinaire tant sur le plan des représentations
sociales des langues que sur celui des usages.
Thématique 4 : Les processus sociaux en Méditerranée : acteurs, systèmes, pratiques et stratégies
A l'instar d'autres régions du monde, les pays du Maghreb ont été profondément touchés par les mesures d'ajustement structurel et de libéralisation économique qui ont visé à réduire à la fois les déficits publics et les interventions des États dans le domaine économique et social. On en mesure aujourd'hui les conséquences négatives, notamment sur le plan social : accroissement des inégalités à tous les niveaux, chômage notamment des jeunes, pauvreté et exclusion, développement des formes d'économie souterraine.
A cette situation critique différentes réponses ont été apportées ou recherchées, par les acteurs de la société civile, d'une part, et par les autorités politiques et les institutions internationales chargées de l'aide au développement, de l'autre.
Les politiques sociales mises en œuvre devront être étudiées dans une perspective comparative, pour identifier leurs orientations principales, leurs convergences et leurs divergences, et leurs résultats. Quatre domaines principaux seront proposés :
- la lutte contre
le chômage, la pauvreté et l'exclusion ;
- les politiques
et pratiques éducatives ;
- les politiques
et pratiques sanitaires ;
- la condition de
la femme.
Ces réponses politiques seront confrontées avec celles
des différents acteurs de la société civile :
familles, réseaux de parenté et de relations, travail au
noir et formes d'activité à la limite de la légalité
(trabendo), mobilisation des ressources de l'émigration,
solidarités communautaires et religieuses anciennes et renouvelées.
Par processus de territorialisation, l'on entend aujourd'hui l'ensemble
des phénomènes institutionnels, organisationnels, socio-économiques,
culturels et politiques qui contribuent à structurer l'espace en
zones rurales et/ou urbaines, celles-ci devenant du même coup le
cadre privilégié des processus et des politiques de développement.
Mais cette territorialisation, qui fixe une nouvelle échelle d'analyse
des transformations économiques et sociales, plus proche de la
réalité que l'échelle nationale, recouvre à
son tour, et tend à masquer des contradictions et des différences
à courte distance qui viennent fragmenter l'image unifiée
de ces territoires et invitent à lui substituer celle d'une peau
de léopard, ou d'une mosaïque en permanente recomposition.
Derrière la délimitation des territoires par la décision
politique et administrative, le développement d'activités
économiques très diversifiées et multisectorielles
met en effet en jeu l'intervention des acteurs locaux, qui réinterprètent
en fonction de leurs propres intérêts ou stratégies
individuelles et collectives les suggestions et les incitations venues
d'en haut.
La comparaison des résultats des processus en cours de territorialisation
dans les différents pays concernés devrait contribuer à
mettre en évidence un jeu complexe de convergences et de divergences,
et permettre de mieux cerner, dans le détail, les traits nouveaux
du paysage socio-économique, culturel et politique tel qu'il se
dessine et se modifie sous nos yeux.
L'environnement constitue à la fois le noyau central et l'enjeu
principal de toutes les politiques de développement. Si celles-ci
en mobilisent toujours les ressources, leur impact peut avoir sur lui
des résultats très différents, et souvent menaçants
ou destructeurs. Cette constatation est évidente en matière
d'utilisation des ressources du sol et du sous-sol : fragiles et limitées,
celles-ci sont exposées à des risques réels d'épuisement
(désertification ou surexploitation des sols, sollicitation excessive
des réserves d'eau pour les besoins de l'agriculture et des villes,
etc.), et leur utilisation est souvent déséquilibrée
au profit d'un secteur ou d'un autre. La même constatation vaut
pour les ressources énergétiques (pétrole et gaz)
et la protection du littoral sur le pourtour méditerranéen.
La réflexion sur les conditions d'un développement durable
dans un environnement aussi fragile, et aussi soumis à la pression
de la croissance démographique, tout spécialement urbaine,
constitue donc une priorité : elle trouve dans le bassin méditerranéen
occidental un champ d'analyses d'un intérêt exceptionnel.
Celui-ci constitue un véritable laboratoire, qui permet de confronter,
à travers une mobilisation de nombreuses disciplines scientifiques,
les expériences et des situations des pays des deux rives.
Le Comité de pilotage, lors de sa réunion du 21 mars 2005, a
adopté le principe
de la sélection de trois ou quatre propositions par thématique
(tout en se réservant la possibilité de modifier cette répartition
en fonction de la qualité scientifique des projets soumis), et
de leur accorder un financement moyen des 50 à 60 000 €
pour trois ans. A ce financement doivent s'ajouter les participations
provenant des ministères et des institutions et organismes de recherche
et de financement de la recherche des deux rives : participations
dont le taux est fixé à 15% pour la France et 5% pour le
Maghreb des montants demandés (cf. infra : conditions
d'éligibilité). L'apport de soutiens financiers complémentaires
provenant par exemple, en France, des collectivités territoriales
et de la coopération décentralisée ou, au Maghreb
comme en France, d'autres sources comme l'Union européenne et ses
programmes internationaux, est également souhaité.
![]() Composante 2 : Formation, échange et mobilité
Composante 2 : Formation, échange et mobilité
Le projet vise à renforcer l'appui aux cycles de formation doctorale en SHS : le soutien aux co-tutelles par la mise en place de bourses de stage en alternance, d'un montant forfaitaire de 1 200 € par mois, pour financer quinze séjours (cinq par pays) de quatre mois par an en France de doctorants maghrébins pendant trois ans, en constitue l'une des clefs de voûte. Cinq allocations de séjour et de recherche de quatre mois, d'un montant identique, seront proposées chaque année à des doctorants français se rendant au Maghreb.
A ces bourses de stage doit s'ajouter l'organisation de séminaires thématiques, de sessions de formation doctorale et d'universités régionales d'été, qui doivent compléter l'action de formation à la recherche.
Les universités régionales d'été seront organisées sur la base du partenariat et sur un mode itinérant. Elles pourront être articulées soit avec l'une des thématiques de recherche retenues dans le cadre de l'appel à propositions, soit avec d'autres sujets transversaux et pluridisciplinaires, tels que le patrimoine méditerranéen, les politiques publiques de l'emploi/formation, le partenariat euro-méditerranée. Deux universités d'été pourront être financées, l'une en 2006, l'autre en 2007, à hauteur de 85 000 à 95 000 €.
Trois sessions de formation doctorale, réunissant une trentaine de doctorants maghrébins et français, une dizaine d'encadrants (dont 2/3 venant de France) et de cinq à dix représentants des institutions concernées devraient être organisées respectivement en Algérie, au Maroc et en Tunisie pendant la durée du projet. Elles donneront lieu au financement de bourses de stages pour les étudiants, de missions pour les enseignants et d'un appui logistique pour les laboratoires ou les universités d'accueil : soit un financement de 55 000 à 65 000 € par session.
Les séminaires thématiques régionaux peuvent être organisés sur un sujet d'actualité et selon une problématique commune à plusieurs opérateurs de recherche.
L'organisation des universités d'été et des séminaires doit être conçue dans une optique de préparation à la recherche (questions méthodologiques, rapport au terrain, problème d'identification de sources et traitement de corpus…) plus que dans celle d'une confrontation de résultats issus de la recherche.
Deux tiers au moins des moyens disponibles pour cette composante seront affectés, selon des modalités définies par le Comité de pilotage, aux projets retenus dans le cadre de l'appel à propositions de recherche conjointe, dont ils devront constituer le prolongement ou l'accompagnement.
Le reste des crédits disponibles sera
utilisé pour financer des séjours post-doctoraux ou de haut
niveau de trois mois destinés à des chercheurs des trois
pays du Maghreb. Douze allocations, d'un montant forfaitaire de
1 750 € par mois, sont prévues pour la durée
du projet. Quatre allocations de trois mois d'un
montant identique sont également prévues pour de jeunes
post-doctorants français. Les procédures de candidature
et de sélection de ces allocations de recherche feront l'objet
d'un appel ultérieur.
![]() Composante 3 : Informations et traductions scientifiques, et compétences
linguistiques
Composante 3 : Informations et traductions scientifiques, et compétences
linguistiques
L'objectif est d'assurer la traduction et la diffusion des ouvrages de référence en SHS, et de renforcer les compétences linguistiques des chercheurs des deux rives. Les volets principaux en sont :
- une politique
d'aide à la traduction en arabe d'ouvrages français en
SHS : celle-ci sera définie et conduite par un groupe d'experts
constitué à l'initiative de la MSH ;
- une politique de formation linguistique visant à renforcer les compétences en français des jeunes chercheurs maghrébins et en arabe des jeunes chercheurs français ;
- la rédaction et la mise en ligne, sous la forme d'une base de données électronique, d'un dictionnaire des sciences sociales, dont les entrées seraient consacrées aux principaux concepts utilisés, dans les deux langues, et viseraient à en préciser les usages et les équivalents les plus couramment utilisés dans l'autre langue.
![]() Composante
4 : Gestion du programme et communication
Composante
4 : Gestion du programme et communication
La gestion du programme se décompose en deux points :
- réunions
et activités des trois conseils, l'évaluation à
mi-parcours étant assurée par le comité de suivi ;
- l'évaluation
finale externe des résultats du projet, et des perspectives de
coopération à plus long terme qu'ils permettent de dégager.
La communication est assurée par la MSH qui a mis en place un portail dédié à ce projet sur son propre site Internet, où tous les chercheurs pourront trouver l'ensemble des informations liées au déroulement du projet, et tous les acteurs sociaux intéressés les résultats des recherches disponibles. La MSH assurera également en fin de projet, en liaison avec la DGCID/SU/A, l'organisation d'un colloque de bilan et la constitution d'un réseau permanent sur les SHS en Méditerranée occidentale.
Maison des Sciences de l'Homme